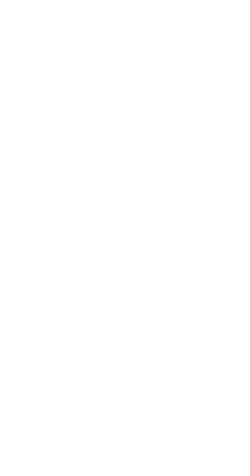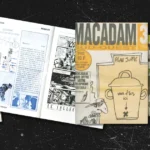Au lancement de la première version de ChatGPT en 2020, certains prédisaient un désintérêt rapide de la population pour cet outil. D’autres – communicateurs, professeurs, scénaristes, auteurs, etc. – ont au contraire mis à profit le long confinement pour plonger dans de l’autoformation quasi frénétique.
Cinq ans plus tard où en sommes-nous ? La compréhension de cet outil reste partielle pour l’utilisateur moyen, mais son accès s’est démocratisé et son usage s’est considérablement intensifié.
L’atrophie cérébrale
Selon une récente étude d’OpenAI, l’usage personnel du chatbot dépasse largement l’usage professionnel : 70 % des conversations concernent la vie quotidienne. Dans les médias apparaissent des drames humains – de la psychose au suicide –, et les alertes se multiplient sur les conséquences d’une utilisation intensive de l’IA sur l’activité cérébrale (notamment chez les jeunes).
Cela étant dit, les connaissances relatives aux effets de l’IA sur notre cerveau sont pour le moment aussi limpides qu’une purée de pois. Gardons à l’esprit que ces constats (dignes d’un roman dystopique) sont les résultats préliminaires d’un champ d’études en pleine émergence et non des données probantes.
Un nouveau proche aidant
Pour les personnes âgées en perte de cognition, touchées par la solitude ou qui aimeraient simplement se maintenir à domicile, un monde nouveau s’ouvre avec l’IA. Les prochaines générations devraient bénéficier de toute une gamme de nouvelles technologies pour mieux vieillir, à en croire le dossier de notre journaliste Anne-Laure Jeanson qui s’est prêtée à l’exercice de vulgariser un sujet particulièrement dense et complexe.
Chose certaine, entre la robotique, et l’intelligence artificielle les secteurs gériatrique et gérontologique ne manqueront pas de leviers pour une « vieillesse assistée », et accompagnée !
Les Alexa de ce monde
Lorsque l’on demande à ChatGPT de nous décrire les dérives d’une utilisation intensive de l’IA de type chatbot, la liste est longue : isolement social, désinformation, atteinte à la vie privée, dépendance technologique, etc. Et l’une d’elles s’observe déjà : la déshumanisation. Il suffit de prêter attention à la réaction de certaines personnes insatisfaites de la réponse vocale d’une Alexa, par exemple. Le ton monte, l’impatience s’installe, parfois jusqu’aux insultes.
Contrairement à un humain, Alexa et la fonction vocale de ChatGPT ne s’offusquent pas. Elle adopte un comportement servile face à l’irrespect.
La « relation » IA-humain pourrait-elle éroder notre empathie jusqu’à ce que l’on ne soit plus capable d’en éprouver envers un autre humain ?
Vous venez de lire un article de l’édition du 1er octobre 2025.