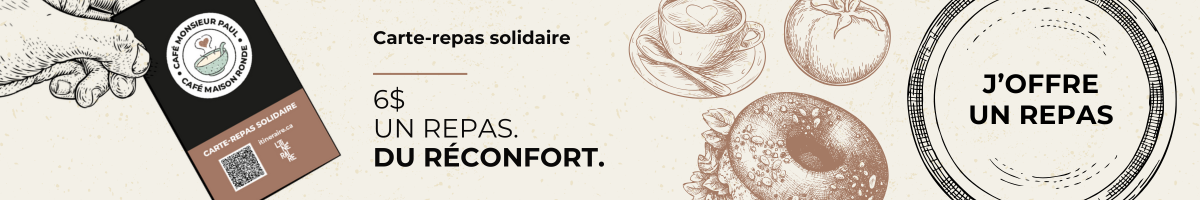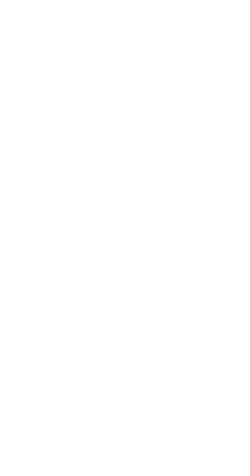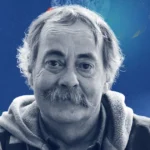Un ceviche mangue et kiwi, des makis au foie gras et oignons caramélisés ou encore un bon cronut, ce croissant frit, ou donut feuilleté (c’est selon). La cuisine dite fusion, issue du métissage des cultures, des techniques et des traditions culinaires, embellit la gastronomie canadienne et québécoise à chaque vague d’immigration, depuis des siècles.
Il en est de même en musique : Labess, un groupe algéro-québécois qui chante Dance me, to the end of love de Leonard Cohen, en arabe ; ou encore Oktoecho, au cœur du dossier culturel de cette édition, qui métisse la musique occidentale, celle du Moyen-Orient et la musique autochtone du Canada.
Dès qu’il s’agit de créer, de surprendre, le métissage est applaudi et souvent récompensé. Et ce, sur toutes les scènes : musicale, linguistique, culinaire, médicale, génétique… sauf sur la scène sociale, où l’on parle d’ailleurs plutôt de mixité sociale.
Ce mélange réveille des réticences dès que l’on met en œuvre des projets concrets ; lorsque Toulouse, ville du sud de la France, a fait le choix audacieux (et réussi) en 2017 de fermer deux écoles de quartiers défavorisés pour forcer la scolarisation de leurs jeunes dans des écoles en milieu aisé, la controverse a pogné. Autre exemple : construire des espaces résidentiels composés de condos et de logements abordables semble tout un défi. Selon l’Ordre des architectes du Québec, il faut bien doser l’écart de richesse entre voisins, éviter la trop grande proximité de logements de jeunes familles et de retraités, construire des espaces et des couloirs de circulation différenciés pour éviter le choc des modes de vie…
Et que dire de l’idée d’un parrainage social pour soutenir des individus enlisés dans la précarité !
Le métissage provoque plus de crispation que d’enthousiasme, voire un sentiment d’insécurité ; la norme rassure, le métissage lui, bouscule. Il oblige à négocier, à écouter, à composer. Il bouleverse l’idée bien internalisée selon laquelle il existerait une bonne manière d’être, de parler, d’habiter, d’exister.
Dans un monde où l’on prétend valoriser la diversité, cette ambivalence est criante et politique. Les États-Unis en sont un bon exemple. En 2021, l’ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, affirmait à l’occasion de la Journée internationale des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale que : « La prévalence et l’omniprésence de la discrimination raciale sont telles que la situation peut sembler désespérée, mais nous gardons espoir. […] Poursuivons nos efforts pour éradiquer cette discrimination et éliminer la pourriture de nos fondations. » Ces mots émanent du même pays qui, une couple d’années plus tard, s’est mis à couper dans les programmes diversité et inclusion des institutions publiques. On s’en doute, Linda Thomas-Greenfield, femme noire, a fini son mandat d’ambassadrice au premier jour de celui de Donald Trump comme président, le 20 janvier 2025.
Autant dire que la mixité sociale n’est pas seulement difficile à mettre en place, elle est parfois même combattue. Les arts et la science sont alors de bons moyens pour ne jamais oublier que sans métissage, la fragilité s’installe.
Vous venez de lire un article de l’édition du 15 juillet 2025.