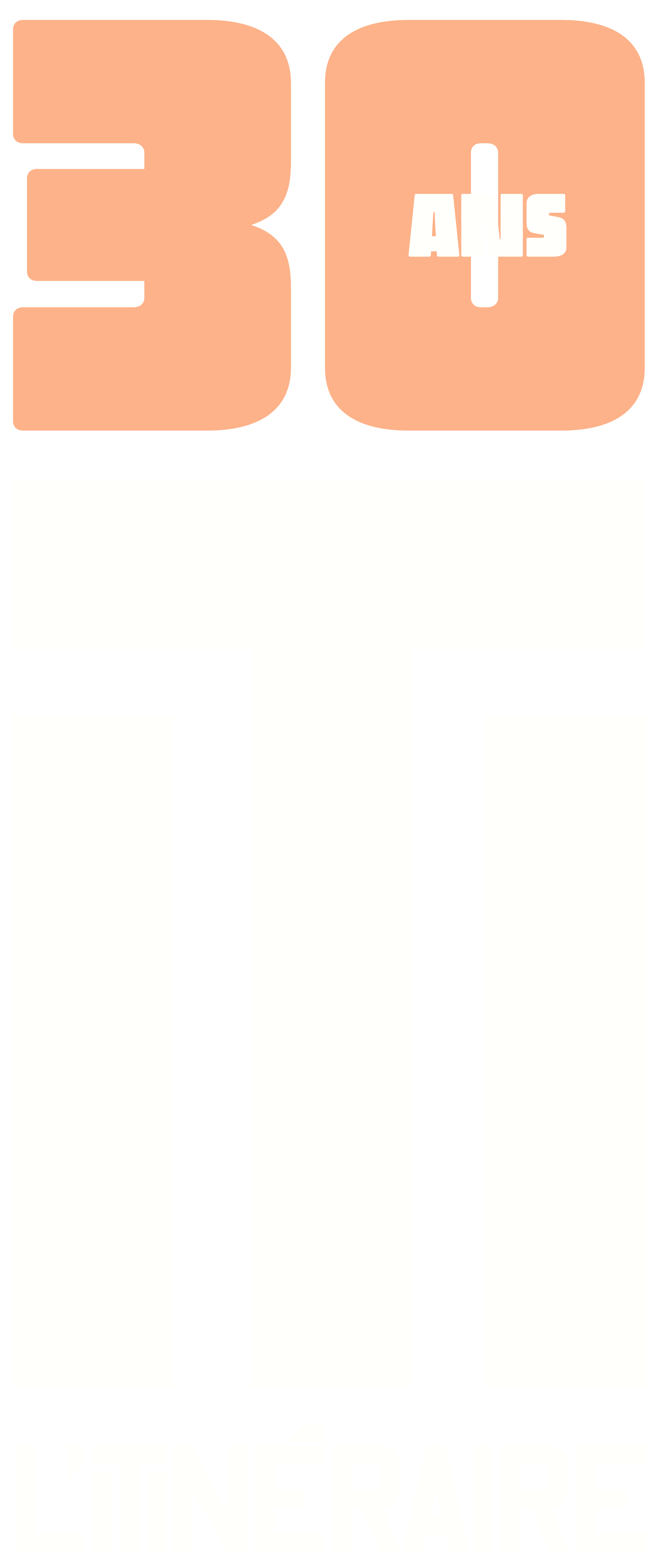L’Itinéraire a rencontré Éric Piccoli, le cofondateur de Babel Films et réalisateur bien connu pour ses deux dernières adaptations des romans : L’écrivain public de Michel Duchesne et Je voudrais qu’on m’efface d’Anaïs Barbeau-Lavalette. Derrière ces deux séries à grand succès, c’est la curiosité de mieux comprendre la vision de l’individu responsable de fictions quasi documentaires, dérangeantes de réalisme, qui a provoqué la rencontre. Et on ne s’est pas trompé. En entrevue, Éric Piccoli révèle un côté de lui socialement engagé et humaniste. Le tout saupoudré d’une volonté de voir changer le monde à travers des mots parfois crus et des images lourdes de sens.
Vous êtes l’un des créateurs de la maison de production Babel Films, dont le slogan est: «Tourner la bonne histoire». C’est quoi pour vous une bonne histoire?
Tourner la bonne histoire, c’est très subjectif, mais c’est notre vision. On cherche à tourner quelque chose qui nous touche personnellement, qui émane de quelque chose de vrai, qui, après ça, peut prendre la forme d’un film, d’une série, d’un documentaire ou d’un court métrage. Quand les gens vont voir notre œuvre, il y a vraiment un dénominateur commun. Il s’agit de tout ramener à ce qu’on est, des raconteurs d’histoires.
Vos deux dernières séries à succès, L’écrivain public et Je veux qu’on m’efface sont des fictions, mais on y trouve un je-ne-sais-quoi de l’ordre du documentaire à travers ce qui est raconté, un reflet de ce que vit beaucoup de monde. Comment faites-vous l’ajustement, la part des choses?
Le documentaire, ç’a la prétention d’être vrai, même quand il y a du montage. Je ne suis pas censé interagir vraiment avec les gens, je ne suis pas supposé leur dire quoi faire. Alors que dans la fiction, tu diriges les comédiens, c’est préparé d’avance. Ç’a la prétention d’être faux. Ce qu’on espère quand les gens vont regarder l’histoire, c’est qu’ils y croient. Mais les deux peuvent s’influencer. On peut faire en sorte de se rapprocher des codes du documentaire selon la manière dont la caméra va bouger, dont le comédien va jouer, en prenant des vrais lieux. Dans L’écrivain public, par exemple, on tourne dans la cuisine collective d’Hochelaga-Maisonneuve, avec des vraies personnes, qui ne sont pas des comédiens. En ayant ces vraies personnes qui tournent dans une fiction, le spectateur se demande jusqu’à quel point ce qui arrive est vrai ou pas. L’idée, c’est de faire que l’histoire qu’on raconte ait l’air le plus réaliste possible. Quelqu’un m’a déjà dit que les meilleurs mensonges sont ceux qui ont le plus de détails.
Quand j’écris des histoires, ma recherche se fait sur le terrain. Alors tout est calqué sur des trucs réels. Dans L’écrivain public, il y a une scène où une dame dit qu’elle a dû mettre un carton dans sa fenêtre tout l’hiver, que ça fait 25 ans qu’elle habite cet appartement, et qu’elle va se faire mettre dehors. Ben cette dame, c’est une amie de mon père. Et le carton dans la fenêtre, c’est sa vraie histoire. Cette dame, tu vois que ce n’est pas une comédienne. Mais dans la scène, tu te dis qu’elle est bonne et tu te demandes si l’histoire qu’elle raconte est vraie. La frontière, elle est là. Lorsque tu mets des acteurs connus à côté de personnes de la vraie vie, tu sais que les acteurs vont jouer d’une autre façon. Il y a un respect étrange qui s’établit.
Et comme on tournait dans une cuisine collective, on ne pouvait pas l’arrêter de fonctionner. Il y avait même des livreurs qui entraient. Plusieurs scènes ont alors été tournées en un seul plan, comme dans un documentaire. On ne peut pas les refaire. Dans certaines scènes, il y avait un groupe de cuisiniers qui venaient en formation. C’étaient des personnes atteintes de déficiences intellectuelles, et elles sont toutes là dans la série. Elles sont en arrière, on ne les voit pas plus qu’il ne faut parce que je trouvais ça délicat, mais elles sont là. La manière dont elles bougent, dont elles font leur truc, ça vient juste rendre le tout plus crédible.
Certains de vos acteurs ont-ils déjà évoqué un malaise en jouant des scènes? Je pense à Je voudrais qu’on m’efface où il y a des scènes très dures entre les jeunes acteurs.
Avec ces acteurs, on a souvent eu des discussions où je leur répétais, lorsqu’ils avaient des commentaires désobligeants du type «ah, mon personnage, ah, j’haïs ça ce que je porte, c’est laid » : T’es conscient que toi demain tu peux choisir comment tu vas t’habiller. Eh bien ton personnage, dans le film, il existe en vrai, mais lui ne peut pas choisir. Ça les ramène souvent à la réalité, mais ce sont des adolescents. Il y a aussi la scène où un gars est insistant avec une fille sur le lit. Le jeune acteur qui l’a jouée m’a dit : « Monsieur, je suis vraiment un trou d’cul. » Je lui ai dit: « Oui, mais t’es pas 2D, ton personnage, tu vois qu’il essaie de comprendre, il est insistant, mais tu n’es pas un violeur, t’es juste un gars qui ne comprend pas, qui n’a pas encore appris que quand c’est non, c’est non ! » Et il a ajouté : « Les gens vont me détester quand ils vont voir ça. » Je lui ai dit que oui, mais qu’il y a aussi peut-être des gars qui vont se reconnaître et qui vont réaliser qu’ils ont déjà eux aussi été insistants comme ça. Et que ça crée des filles qui ne se sentent pas bien après et qui perdent confiance envers les gars.
Dans L’écrivain public, on a Sandrine Bisson qui joue une fille avec une déficience intellectuelle. Pendant le tournage elle me disait: « Ben là, je me sens mal de faire semblant d’avoir une déficience quand il y a des gens juste à côté de moi qui en ont vraiment une ». Je lui ai répondu que c’est ça le respect qu’on est censé avoir avec ce qu’on raconte. Parce que quand tu racontes quelque chose, tu deviens la voix des personnes que tu décris. Ça fait que tu ne peux pas faire une caricature.