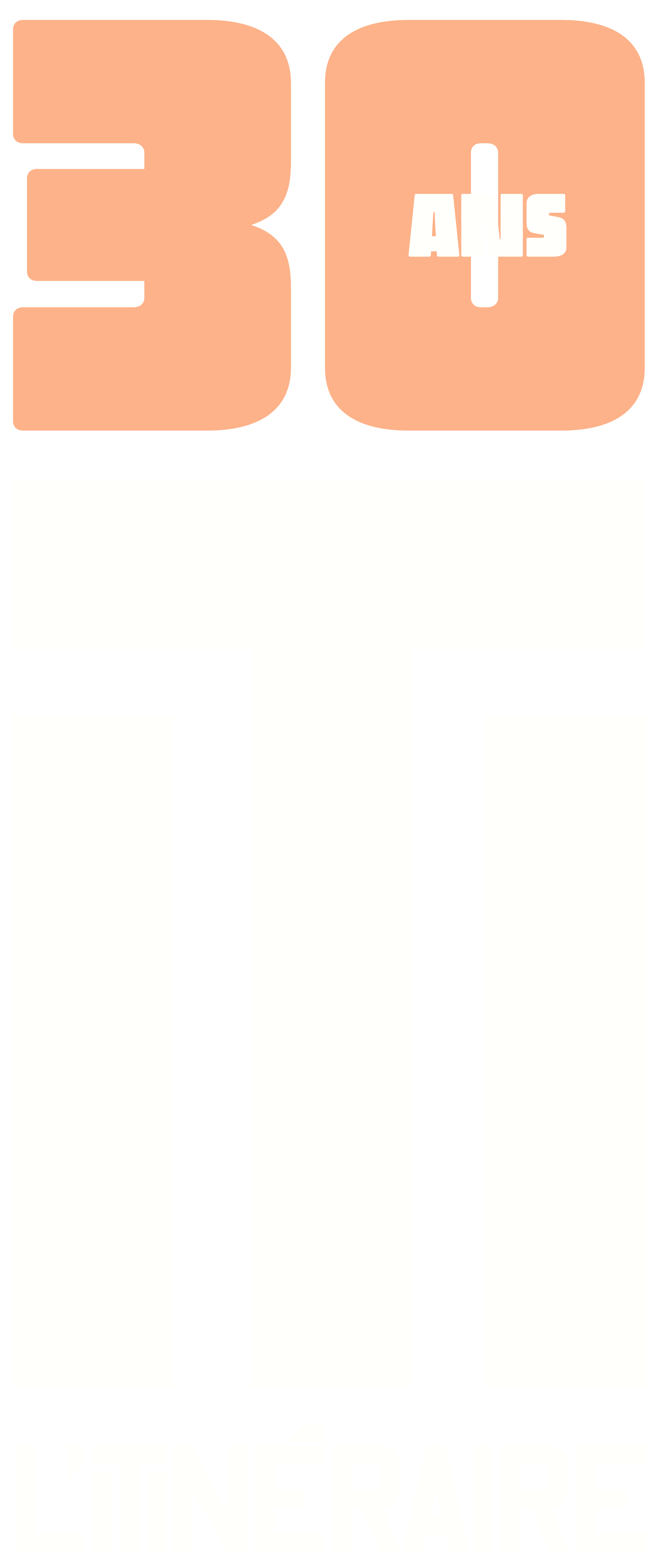Entrevue avec Mélissa Blais, professeure de sociologie au département des sciences sociales de l’Université du Québec en Outaouais. Elle se passionne pour le féminisme et le masculinisme depuis que ses études, ses implications militantes et sa prise de conscience des conditions dans lesquelles évoluent les femmes lui ont fait l’effet d’un électrochoc. Dès lors, elle se penche sur ces mouvements de société en tant que femme militante et universitaire.
Pensez-vous que les femmes connaissent assez leur histoire ?
Comme dans bien des pays, l’histoire nationale est montrée du point de vue des hommes blancs, des conquérants, des hétérosexuels… Après, c’est par choix qu’on s’intéresse à celle des femmes. C’est sûr qu’à travers le cursus scolaire on peut voir de grandes figures de femmes, de bâtisseuses, comme Jeanne Mance, mais par exemple, les premières esclaves noires qui se sont libérées, on n’en parle pas.
Puis, on découpe souvent l’histoire selon la vision de l’Occident ou de l’Europe : Le Moyen Âge, la renaissance, la modernité… Mais cette façon de faire n’est pas du tout pertinente. La Chine par exemple n’a pas connu le Moyen Âge. Quant aux femmes, la Renaissance a été pour elles un véritablement backlash en Europe. Elles devaient désormais prendre le nom de leur mari alors que rien ne l’imposait au mi-Moyen Âge. C’est aussi l’époque où l’on oblige les sages-femmes à déclarer les accouchements, on se met à punir le travail de prostitution, les femmes que l’on estime être adultères. On contraint les libertés des femmes. Et pendant ce temps, on parle de renaissance comme si nous quittions une grande noirceur.
On constate que les conditions de vie des femmes ont quand même grandement évolué depuis les suffragettes. Mais tout le monde s’accorde à dire qu’il reste beaucoup de travail. Où en sommes-nous ?
On ne dit plus aujourd’hui que les femmes sont inégales. On ne plaide plus comme le faisait Henri Bourassa qui disait que les femmes sont inférieures intellectuellement. Et ça, c’est grâce au féminisme. Mais concernant les avancées, j’appellerai à la vigilance constante parce que, comme le disait Simone de Beauvoir, il suffit d’une crise pour que les droits des femmes soient ébranlés. Ça s’est déjà vu. Les femmes ont perdu le droit de vote, le droit de porter les armes, à des époques où elles avaient des libertés. Ce sont des privilèges qu’elles ont dû « re » conquérir. Vers 1800, au Canada, les personnes qui possédaient une certaine richesse pouvaient voter. En oubliant de préciser le sexe de ces personnes, quelques femmes se sont prémunies de ce droit. Or, ce sont les Patriotes, souvent célébrés comme de grands démocrates, qui leur ont enlevé le droit de vote en précisant la mention sexe. Au Moyen Âge aussi les femmes avaient le droit de vote. Le système politique n’était pas le même, mais elles étaient dans les assemblées d’habitants où se tenaient des délibérations et des décisions collectives sur les besoins de la communauté. Et là, les femmes votaient.
Vu comme ça, la société ne semble pas être prête à changer profondément ses mentalités…
La première vertu des féministes, c’est la patience. Obtenir le droit de vote a pris entre 100 et 150 ans. Alors si on prend l’exemple des mouvements de lutte contre les violences faites aux femmes qui ont débuté dans les années 1970, espérer des changements sur un sujet aussi complexe et profond, c’est un peu tôt.
Ça me semble impossible d’en parler tant et aussi longtemps que l’on sera pris dans cette idée que les hommes et les femmes sont différents par nature. Aujourd’hui, les forces antiféministes se saisissent de théories pseudoscientifiques pour démontrer que les hommes et les femmes sont complémentaires. Cette conception dit que dans la complémentarité, il y a un travail d’homme et un travail de femme. Si on analyse bien, on voit que celui des femmes est hiérarchiquement moins prestigieux, moins bien payé et qu’il relève des mêmes dynamiques qu’autrefois en les renvoyant au travail dans le domaine des soins.