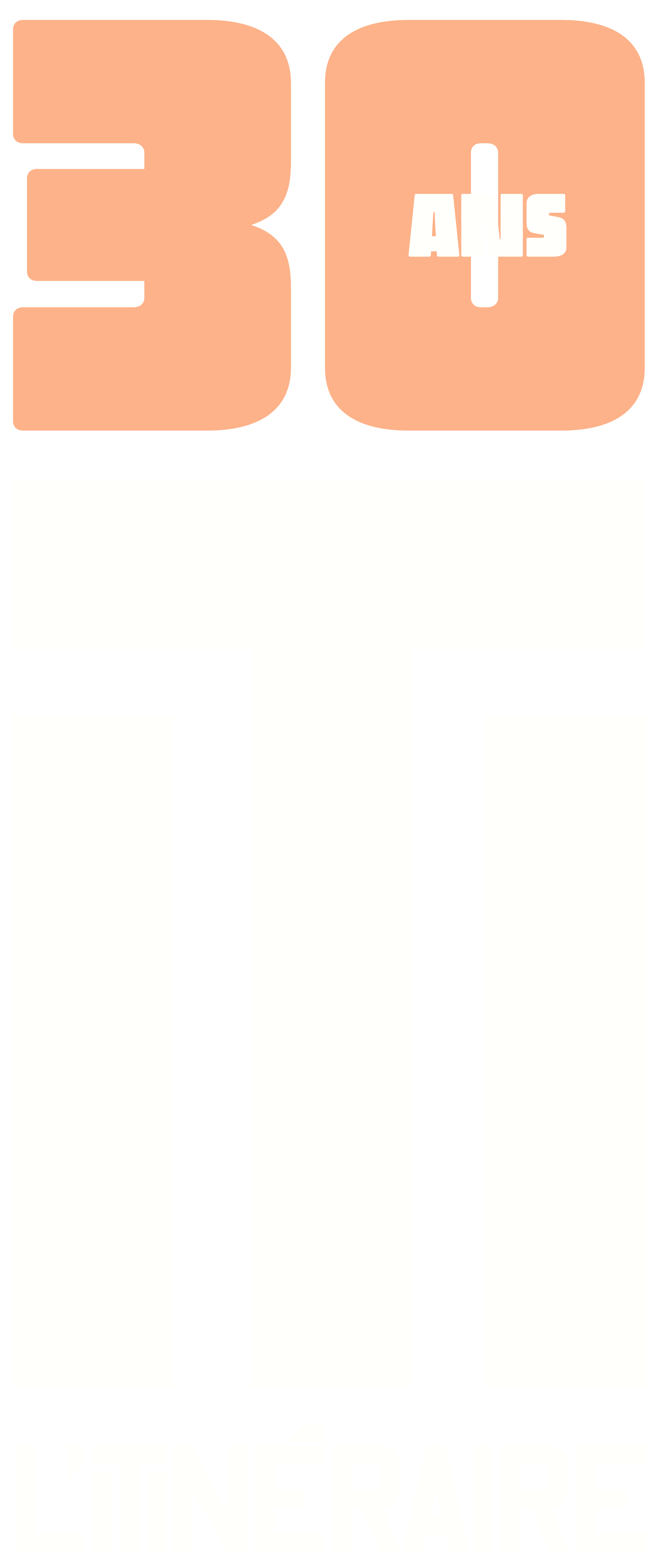Depuis plus d’un an et demi, elles et ils nous soignent sans compromis, parfois au détriment de leur santé mentale et vie personnelle. Baptisés naïvement « les anges gardiens » par le gouvernement provincial, on dit souvent que leur métier est une vocation. Comme pour justifier leurs conditions de travail, légitimées par les décrets et arrêtés ministériels. Les « mercis » mentionnés en conférence de presse ne suffiront pas à les retenir dans la profession. Refus de congés, délestage ou isolement obligatoire sont autant de raisons qui les poussent à partir.
Au Québec, la pandémie a eu raison de plusieurs d’entre elles : entre la mi-mars et les mois de juillet et d’août derniers, plus de 1 700 infirmières ont quitté leur emploi (selon une compilation de Radio-Canada, 15 septembre 2020). Début avril 2021, on dénombrait 5 000 absents COVID chez le personnel soignant. Et même si d’autres embauches ont eu lieu, la fatigue se lit sur leurs visages. Pour toutes ces raisons, L’Itinéraire les met à l’honneur, car sans elles et eux, on viendra difficilement à bout de cette crise sanitaire.
La science du coeur
L’activité apparaît dès lors comme le prolongement des mouvements de charité et de philanthropie. Le terme « ange gardien », galvanisé au début de la pandémie, en est un exemple très clair, selon l’historienne et professeure Yolande Cohen. « Mais sans moyen, sans reconnaissance ou amélioration de leurs conditions de travail, qui prend soin d’elles en retour ? ».
Dès le départ, les femmes ont occupé une place prépondérante dans cette activité associée à l’acte charitable, celui de prendre soin des autres parce que, dira-t-on, tel était leur devoir. On a d’ailleurs souvent lu que les femmes avaient l’habitude de prendre soin des autres, « ce qui est formidable pour celles qui ont cette vocation », prévient la professeure, « mais qui n’a rien à voir avec le fait d’être une femme. C’est plutôt l’envie d’aider les autres qui doit être considérée. »
Même si les infirmiers sont aujourd’hui plus nombreux qu’avant, les femmes sont encore majoritaires. « Si cette vocation initiale était reliée au fait d’être une femme, ce qui n’est pas un fait naturel, mais plutôt une construction sociale, la formation rigoureuse devrait mener à une rémunération au même titre qu’une formation médicale ou universitaire », estime Mme Cohen.
Ce problème de valorisation du soin a été exacerbé avec la pandémie. « Tous ces métiers qui étaient invisibles, dévalorisés, déconsidérés, non reconnus et pas nécessairement appréciés, sont devenus un travail essentiel bien qu’il ne soit pas rémunéré à sa juste valeur. C’est peut-être là le lien avec un métier typiquement féminin. » Ceci sans oublier que la vocation était obligatoire pour les religieuses et un devoir pour les autres femmes qui devaient s’occuper d’abord de leur famille puis des plus vulnérables. « On peut leur donner le titre magique d’ange gardien qui viendra nous sauver sans qu’on ait besoin de le payer. ».
Un siècle de réformes
La plupart des réformes de cette profession semblent avoir été motivées par des impératifs économiques. La toute première association des infirmières diplômées (1917) se focalisait sur le service bénévole aux malades, au détriment de la formation.
La même idée est un peu reprise trois ans après avec l’Association des gardes-malades enregistrées de la province de Québec qui obtient le monopole.
Bien que l’adhésion ne soit pas obligatoire, pour être membre, il faut tout de même être une femme d’au moins 23 ans, célibataire, de bonne réputation et avoir réussi un cours de trois ans dans un hôpital d’au moins 50 lits. Celles qu’on appelle les gardes-malades peuvent faire des prises de sang, administrer des injections et prendre la tension artérielle.
Il faudra attendre presque 27 ans pour que soit créée une autre association, celle des infirmières de la province de Québec, à qui l’on doit une définition du métier exercé par « toute personne de sexe féminin possédant les qualités requises et qui est autorisée à rendre, moyennant rémunération, des services touchant le soin des malades et à donner des soins destinés à prévenir la maladie ».
En 1930, un mouvement en faveur de l’institutionnalisation des soins infirmiers fait quasiment disparaître les services privés (qui représentent près de la moitié des services actuels). Trente ans après, certaines choses se débloquent comme la diminution de l’âge d’exercice à 18 ans ou le droit donné aux hommes d’obtenir un permis d’exercice. C’est aussi vers ces années que nait le problème de reconnaissance des acquis pour les professionnelles immigrantes qui devront faire leurs classes pour exercer au Québec. Après tout, n’entre pas qui veut dans la profession, même si le besoin est criant.
Treize ans après, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec est créé. Un monopole de l’exercice infirmier naît. On donne la possibilité de déléguer aux infirmières auxiliaires et on définit un peu mieux le cadre d’intervention de l’infirmière qui devient un membre à part entière de l’équipe médicale. Il faudra attendre cependant le contexte politique et social des années 2000 pour qu’on commence à réajuster la vision du métier qui se bat contre de nouveaux maux, comme le virage ambulatoire, le manque d’accès aux soins et la pénurie de professionnels ou les problèmes de santé mentale.