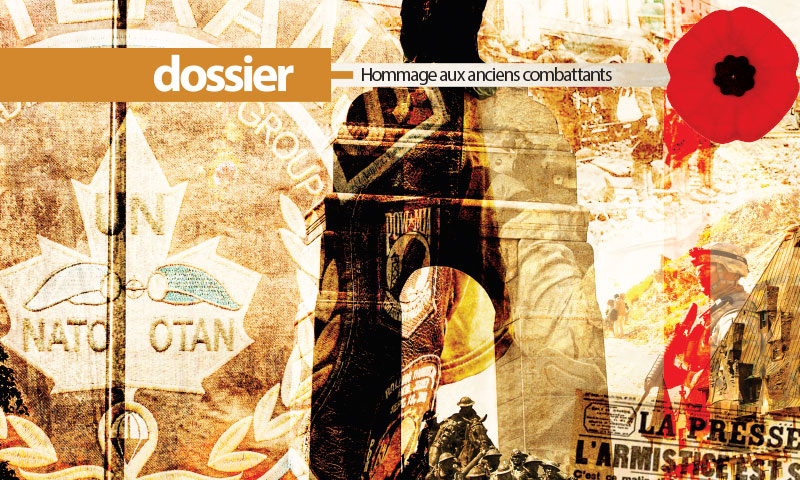Cette devise est partagée par les vétérans que nous avons rencontrés. Visiblement touchés que l’on puisse s’intéresser à leur histoire et qu’on les raconte à l’approche du 11 novembre, jour du Souvenir. Malgré le temps qui passe, leur engagement pour le pays n’a pas de limite. Peu importe ce qu’ils ont vécu, ce qu’ils ont perdu ou les ordres qu’ils ont reçus, ces anciens combattants ont défendu la feuille d’érable et nos valeurs nationales. Ils ont signé de leur vie au nom de tout cela. Voilà pourquoi nous les saluons dans ce dossier hommage.
En arrivant à l’Hôpital Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-Bellevue, les mesures de sécurité dès l’entrée nous plongent directement dans la réalité : « ici, ce n’est pas vraiment un hôpital comme les autres », nous prévient-on en français et en anglais. Le bilinguisme est de rigueur puisqu’il s’agit du seul hôpital au pays à se consacrer exclusivement aux soins des vétérans des Forces armées canadiennes de tous les âges, et ce, depuis plus de 100 ans.
Il a été créé à une époque où l’on se remettait de la bataille de la Somme (1916) qui a fait un nombre important de blessés, tués ou portés disparus. Cette bataille, surnommée « das blutbad » (le bain de sang) par les Allemands, qui ont aussi eu de nombreuses pertes, reste pour plusieurs synonyme des horreurs de la Première Guerre mondiale.
Au fil des ans, l’établissement a solidifié son expertise dans divers domaines comme la gériatrie, les soins de longue durée ou de fin de vie, la démence, la gestion de la douleur ou les traumatismes liés au stress opérationnel (TSO) ou choc post-traumatique.
Au champ d’honneur
Dans les couloirs du rez-de-chaussée, on arrive devant une œuvre célébrant le coquelicot rouge, cette fleur glorifiée par le poème Au champ d’honneur de John McCrae, devenus tous deux des symboles du Souvenir. Puis, on se retrouve face à une sorte d’arbre de métal, fixé au mur, immortalisant sur des feuilles le nom de tous les résidents qui sont partis.
À côté de ces différents hommages, la vie est bien présente. On entend des rires entre les membres du personnel et des discussions somme toute banales des résidents. Difficile de croire que nous sommes dans un hôpital. Le hall d’entrée contient différentes vitrines dans lesquelles on a exposé des photos d’époque ou des objets fabriqués des mains des anciens combattants qui suivent des ateliers d’ébénisterie.
Au Canada, on célèbre le jour du Souvenir, anciennement appelé jour de l’Armistice, tous les 11 novembre à 11h, et ce depuis 1921, année où le Parlement du Canada a adopté la Loi du jour de l’Armistice. Dix ans après, on décide de séparer ces célébrations de celles de l’Action de grâce. Ce jour rend hommage à la fin de la Première Guerre mondiale et permet de se souvenir de ceux et de celles qui ont défendu la nation, au prix de leur vie.
L’Itinéraire a eu l’occasion de rencontrer quelques-uns de nos anciens combattants. Certains ont participé à la Première et à la Deuxième guerre mondiale et d’autres ont été en Afghanistan ou en Syrie. Entre l’Hôpital Sainte-Anne et une ride en moto, nous vous racontons leurs histoires.
« It’s a great day to be a soldier »
À chaque fois qu’il partait en mission, Gino Moretti (60 ans) écrivait une lettre à sa femme, Carole Quenneville (62 ans). Elle ne devait l’ouvrir que s’il lui arrivait quelque chose sur le terrain, que s’il ne rentrait pas à la maison. Gino Moretti n’a pas voulu confier ce qu’il lui écrivait. Sa femme ne le saura jamais puisque dès qu’il rentrait de mission, il détruisait l’enveloppe. Comme s’il fallait oublier des mots écrits dans un moment où il se demandait intérieurement s’il allait revenir à table partager un repas avec les siens.
Derrière la porte close de la salle bleue où se déroule notre entrevue, Gino Moretti et Carole Quenneville discutent avec Marie-Christine Gauthier, leur travailleuse sociale. Elle semble importante dans leur relation. On la voit rassurer le couple avant leur entrée qu’ils font main dans la main d’un pas assuré, comme pour nous montrer qu’ils sont ensemble dans cet exercice stressant de se dévoiler à d’autres « parce que la santé mentale se doit d’être démystifiée pour dire qu’on peut vivre avec ses symptômes, si on travaille en ce sens », explique Mme Gauthier.
En couple depuis 23 ans, mariés depuis sept ans, ils sont parents de deux garçons de 29 et 27 ans. Toute leur vie tourne autour des affaires miliaires dans lesquelles ils se sont engagés. Un peu pour suivre la tradition familiale, mais surtout par envie de défendre certaines valeurs démocratiques et trouver un sens à la famille en honorant une fierté de servir l’autre.
Gino Moretti a atteint le grade de sergent-major tandis que Carole Quenneville travaillait dans les télécommunications avant de finir par prendre sa retraite militaire pour suivre son mari à l’académie d’El Paso, au Texas. « C’était en 1998. Je suivais Gino tout en restant impliquée dans différentes activités militaires. C’était trois ans de vie de famille exceptionnels là-bas. C’était la ville de rêve », se souvient Mme Quenneville.
S’en suit un départ à Kingston pour enseigner avant qu’il finisse par retourner aux opérations à la suite des évènements du 11 septembre 2001. Deux ans après, Gino Moretti est déployé en Afghanistan où il joue un rôle de première ligne dans le combat en formant des soldats en négociation et en règlements de conflits.
Un sursaut l’envahit lorsqu’il prononce le nom du pays d’Asie centrale. Sa femme attrape sa main tremblante pour qu’il puisse continuer de parler. Les premières larmes commencent à couler. Mais ce n’est rien de négatif, c’est juste la preuve que cette discussion est réparatrice. « De 2003 à 2012, année de sa retraite, j’étais quasiment monoparentale parce qu’il n’était jamais là, témoigne Carole Quenneville. Il y a eu des moments où l’on ne se voyait qu’une fois de temps en temps, aux 18 mois. »
Esprit de corps
L’éloignement a permis au couple de mettre en place différents trucs, appris notamment à l’armée, comme l’esprit de corps. À la maison, chaque fois que Gino Moretti devait être déployé quelque part, il y avait des conseils de famille qui permettaient de prendre une décision commune, avec leurs enfants et surtout d’aviser des conséquences de celle-ci, parce qu’il y en aurait forcément.
Même si Gino Moretti était absent, sa femme et ses garçons continuaient de vivre. À l’époque, les technologies n’étaient pas si développées qu’aujourd’hui. Il pouvait donc lui arriver d’attendre ses appels à la maison. Mais dès qu’elle a eu un cellulaire, elle a refusé d’attendre un de ses coups de fil. Si elle l’avait au téléphone, tant mieux, sinon ce serait pour une autre fois. La vie devait absolument continuer, l’équilibre familial en dépendait. « Parmi les difficultés du retour, je crois que Gino avait du mal à comprendre qu’on avait avancé et que les choses n’étaient plus au même stade qu’à son départ. Il devait toujours se réadapter à nous et inversement », raconte-t-elle.
Pour lui permettre de suivre l’évolution de la famille et des enfants, Carole Quenneville disposait sur la table du salon une boîte dans laquelle chacun pouvait déposer des objets qui permettraient à au paternel de comprendre les moments clés de la famille, même s’il était absent.
Dans cette boîte, qui lui était envoyée par courrier, on y retrouvait un emballage d’une sucrerie préférée, des photos ou des bribes de pensées. Cela lui permettait de vivre par procuration certains événements. Et, chaque fois qu’il rentrait, le papa questionnait ses enfants sur les moments primordiaux qu’ils avaient vécus et qu’il devait absolument connaître.
« On revient de loin »
Comme d’autres soldats, Gino Moretti vit avec un trouble de stress opératoire (TSO), un trouble de santé mentale qui peut apparaître à la suite d’un évènement traumatique comme être confronté à la mort ou à la peur de mourir, ou craindre pour son intégrité physique ou celle d’une autre personne. C’est la raison pour laquelle aucun mot ne sera prononcé sur la guerre, sur ses missions et les atrocités qu’il a vues ni même sur les cauchemars qui ont suivi. Malgré ses douleurs qui se révèlent dans des maux de dos atroces, lui faisant notamment changer de positions sur sa chaise, ses symptômes ne l’empêchent pas de fonctionner au quotidien, il a juste appris à vivre avec.
Vulnérabilité
L’ancien militaire est toujours aussi engagé auprès de la communauté, c’est d’ailleurs pour cela qu’il a accepté un mandat de maire de Saint-Anicet. « Je me suis enrôlé pour servir mon pays avec fierté et honneur. Et même si je suis malade aujourd’hui, confie l’ex-soldat avant de faire une longue pause pour ne pas craquer, les services offerts par l’hôpital Sainte-Anne, me permettent de garder cet honneur et cette fierté de servir ma communauté. Et c’est ce que je fais chaque jour en tant que maire. Je crois en la politique, lorsqu’elle est sincère et motivée par les bonnes raisons : servir. »
Marie-Christine Gauthier nous explique en aparté que le plus dur pour M. Moretti pendant leurs rencontres a été d’admettre que sa vulnérabilité n’était pas une faiblesse. À cause de ses symptômes liés au TSO, il a été entraîné pour prévoir le danger. Il est donc habitué à scanner l’environnement au cas où il arriverait quelque chose, comme si son cerveau ne parvenait pas à se rassurer. Et, vivre en continu sur ce mode est forcément épuisant.
L’intervenante et l’épouse ont donc collaboré pour trouver des stratégies permettant à Gino Moretti d’éviter d’être bloqué par son hyper-vigilance, de lui apprendre à doser et l’aider à accepter son corps et son cerveau blessés. « Si on est encore ensemble aujourd’hui, c’est grâce à toutes ces démarches et rencontres. On revient de loin… On l’oublie souvent, mais s’il vit avec un TSO, je vis aussi cette maladie…», conclut sa femme sans parvenir à retenir ses larmes.
« Christmas is not easy »
Quand il arrive dans la salle bleue, David Ryan, 66 ans, porte fièrement son veston aux couleurs de Vétérans UN-NATO Canada, un regroupement international qui se donne pour mission de sortir les anciens militaires de l’isolement par diverses activités.
En analysant les badges de son veston, on comprend que le Golan, Israël et l’Afghanistan ont été les terrains de ses principaux déploiements. Mais il y a eu aussi des déplacements en Syrie, en Angleterre, en Écosse, aux États-Unis, en Égypte et en Allemagne. « Quand je remonte la ligne du temps, je peux juste dire que c’est réel, c’est la vie réelle… », dit-il.
À ses côtés, sa complice, Danielle Boudrias, complète ses phrases tout en montrant avec une certaine fierté des photos de lui sur le terrain. Elle n’a pas fait l’armée, mais elle est sa plus grande supportrice. Avec sa compréhension des papiers gouvernementaux, elle l’aide à effectuer les démarches administratives pour qu’il reçoive sa pension, par exemple.
David Ryan a rejoint les Forces armées canadiennes lorsqu’il était dans la vingtaine pour respecter une tradition familiale héritée de son frère, de son père et de son grand-père. Il a commencé à Valcartier en tant que soldat et a pu monter jusqu’aux grades d’adjudant et caporal-chef. Si tout cela était à refaire, ce serait sans hésiter. « C’est une vie de loyauté, une vie de discipline, une vie d’engagement et surtout des amitiés fortes. Ce n’est pas qu’un job, c’est ta vie réelle pour la vie », insiste-t-il.
Il reste évasif quelques minutes. « J’ai été libéré de mes fonctions militaires pour des raisons médicales. Quelque chose s’est passé en Syrie… des traumas comme on dit. Mais quand ça t’arrive, tu prends du temps à comprendre ce qu’il se passe. »
Tout a effectivement basculé le 23 décembre 2014 pendant le temps des Fêtes. Moment d’absence, pensées troubles, tremblements, même les programmes diffusés à la télévision l’effrayaient. « Les médecins m’ont demandé si je me droguais, si j’étais sous l’effet de quelque chose de particulier, mais non, ce n’était pas ça… »
David Ryan comprendra par la suite qu’il a ressenti un stress opérationnel dû aux grandes responsabilités qu’il avait à ce moment-là. Ces apprentissages sont très récents : quand nous l’avons rencontré, il venait tout juste de terminer sa thérapie à la clinique TSO de l’hôpital Sainte-Anne.
Happy hour pour les aînés
David Ryan et Gino Moretti sont ce que l’on appelle dans le jargon militaire des jeunes vétérans. Cela signifie qu’ils n’ont pas participé aux guerres mondiales et à la guerre de Corée. Pour retrouver ces anciens combattants des conflits qui ont chamboulé l’ordre international, il faut se rendre quelques étages plus hauts, dans la salle d’activité.
Joyce Sanders (97 ans), Stuart Vary (88 ans) et Vincent Lavoie (100 ans), tous les trois vétérans de ces grands conflits, entrent chacun leur tour sur leur 31 et arborant fièrement leurs décorations militaires. Ils sont heureux de nous parler de ce qu’ils ont vécu, heureux qu’on s’intéresse à leur vie.
La rencontre se déroule comme leurs rendez-vous quotidiens, type happy hour, aromatisés au vin et aux souvenirs, un de leur moment d’échanges privilégiés rempli d’une grande complicité, d’une grande tendresse amicale.
Dans son fauteuil roulant, Joyce Sanders hésite un peu à prendre la parole. Elle ne connait pas vraiment la guerre du point de vue canadien parce qu’elle était engagée dans l’armée anglaise avant d’épouser son défunt mari, qui lui était caporal dans les Forces armées canadiennes. « Quand ils ont bombardé Londres, nous avons perdu notre maison, nous devions partir. Mes souvenirs sont flous… Je peux juste dire que c’était 42 jours et nuits où nous étions bombardés. L’Angleterre traversait un mauvais moment, ils avaient besoin de tout le monde qu’ils pourraient avoir. Il fallait que je les rejoigne. Mon père et mon frère étaient dans l’armée, j’ai donc rejoint l’armée », confie-t-elle.
Joyce Sanders faisait partie de ces milliers de jeunes femmes qui ont rencontré et épousé des militaires canadiens au cours des deux grandes guerres, c’est une War Bride. Par amour, elle a suivi son mari et c’est au Canada qu’ils ont fondé leur famille. « Il était en Grande-Bretagne depuis quelque temps avant que je ne le rencontre. Je me souviendrai toujours du jour où sa famille m’a accueillie en me disant Bienvenue au Canada ! » partage-t-elle avec émotion.
Son compère, Stuart Vary « tirait des gros canons » dans l’artillerie canadienne pendant la guerre de Corée. Le Canada faisait alors partie des 16 pays qui ont participé à ce conflit au sein d’une force militaire des Nations unies.
« J’y suis allé en 1952 et suis rentré en 1953. J’ai tiré des pièces d’artillerie de campagne de 25 livres pour protéger notre unité. Vous savez, personne n’aime la guerre. Mais, il fallait défendre notre pays, ce n’était pas vraiment une question d’aimer la guerre. C’est difficile à expliquer, il faut le vivre pour le comprendre. » Stuart Vary fait une pause et regarde ses médailles. « Elles sont là pour nous dire merci d’y avoir été. C’est important de se souvenir ! »
Rattrapés par l’amour
Quant à Vincent Lavoie, qui a fait toute la campagne d’Italie, du sud au nord, pendant la Seconde Guerre mondiale, il ne porte ses médailles que très rarement. « C’est parce que j’essaye d’oublier l’impression que j’ai eue pendant toutes ces batailles. Même si j’ai de bons souvenirs, comme celui de ma rencontre avec le pape qui m’a donné un chapelet, il y a certaines choses que je préfère oublier. »
À l’hôpital, il ne passe pas vraiment inaperçu avec sa marchette. On le décrit comme un homme toujours à l’heure, bien habillé, avec un humour candide, mais réconfortant. Et, même s’il y a eu une histoire de guerre, il préfère conter son histoire d’amour avec celle qui est devenue sa femme, Nora Patten, décédée en 2014.
Lorsqu’ils se sont rencontrés, lors d’une cérémonie en Grande-Bretagne, ils devaient partir au front. Elle était dans l’armée de l’air et lui dans l’artillerie. « On s’est retrouvés après la guerre. J’ai été faire mes adieux à sa famille en Grande-Bretagne et elle est venue ici, d’abord en visite, puis nous nous sommes mariés à Montebello et avons eu quatre enfants », se souvient-il. « Je ne vais pas vous raconter tous les détails quand même », dit-il en riant.
À la fin de sa carrière militaire, il travaille pour des compagnies d’assurance et de construction avant d’acheter une ferme sur la côte Azélie à Notre-Dame-de-Bonsecours pour y élever du bétail. Il devient ensuite enseignant en langue française à l’école de Sedbergh, au nord de Montebello.
Nouveau centenaire, Vincent Lavoie est le grand-père de sept petits-enfants et l’arrière-grand-père de six arrière-petits-enfants. Son secret pour se maintenir en forme ? Marcher entre trois et quatre kilomètres par jour et faire du vélo stationnaire dans sa chambre.
L’obligation de se souvenir
Geneviève Richer, médecin généraliste et cheffe du service médical à l’Hôpital Sainte-Anne et Martine Daigneault, infirmière et coordonnatrice des services d’hébergement, ont toutes les deux organisé la 75e commémoration du débarquement en Normandie en juin dernier. « C’était particulièrement important puisque c’est probablement la dernière fois que des vétérans qui étaient physiquement sur place il y a 75 ans, des personnes qui ont aujourd’hui plus de 95-100 ans pour ceux qui avaient entre 18 et 20 ans en 1944, pouvaient y participer », explique Dre Richer.
« C’était quelque chose de les amener outre-mer, avec les grosses journées que l’on vivait là-bas, se lever très tôt et se coucher très tard, la route en autobus, la marche pour se rendre sur les lieux de l’évènement et toutes les précautions sanitaires à prendre. C’était toute une aventure pour eux comme pour nous », ajoute Mme Daigneault. Au-delà d’une logistique impressionnante, elles se souviennent avec émoi de moments touchants qui font la force actuelle des anciens combattants. Elles qui s’attendaient sans doute à voir resurgir des émotions enfouies, eux qui en tout temps se tenaient droits face à la mer, bien décidés de profiter de ce moment qui n’était que pour eux, pour les remercier.
Le 6 juin dernier, 37 vétérans canadiens, dont trois résidents de l’hôpital Sainte-Anne, ont ainsi pu se rendre en Normandie, avec un membre de leur famille. On se souviendra avec une certaine émotion de la vidéo quasiment virale de l’ancien caporal Jean Trempe qui a demandé à se mettre les pieds dans l’eau de la plage Juno avec quelques-uns de ses camarades. Et, s’il ne l’avait pas fait à ce moment précis, il aurait certainement encore en lui l’image d’une eau trouble, couleur rouge sang.
« Never forget who we are »
On quitte l’Hôpital Sainte-Anne pour rencontrer d’autres vétérans, ceux qui se retrouvent quasiment chaque fin de semaine pour contrer le TSO à leur façon, en faisant de longues balades en moto. Le rendez-vous est donné un dimanche d’automne en fin d’après-midi à la traverse de Hudson/Oka.
Plus d’une dizaine de personnes sont heureuses de se retrouver pour rouler ensemble jusqu’au Montreal Skeet Club, un centre de tir situé sur la route 338 au village des Cèdres.
En chemin, l’esprit de corps ressurgit, on s’assure que tous suivent le groupe, chacun veille sur l’autre et tout se fait dans un esprit de camaraderie sans faille. Personne ne double personne, tout le monde se respecte sur la route et s’assure que l’autre va bien. Ces petites attentions sont en quelque sorte ce qu’il reste de leur formation militaire.
Arborants les couleurs des vétérans UN-NATO Canada, Jean Gallagher, Roland Cregheur, Stephane Van et Daphnée Seiz sont de ceux et celles que nous avons rencontrés. « Il faut vraiment préciser qu’on n’est pas un groupe de motards ! », entend-on dans la foule lors d’une photo de groupe.
Cette nuance a toute son importance puisque même si beaucoup d’entre eux sont en moto, leur mission principale est de briser l’isolement des anciens combattants. « Rien que le fait de discuter avec du monde qui comprend ce que tu as pu ressentir, c’est beaucoup », soutient Stephane Van en expliquant le sens de ses différents tatouages sur ses bras. Certains portent le nom de son régiment, quand d’autres rendent simplement hommage à ceux qui sont tombés au combat.
Chaque membre du groupe a son histoire propre. Il y a ceux qui s’impliquent au Café du Soldat de la Maison du Père à Montréal pour soutenir les anciens combattants qui frôlent l’itinérance et l’isolement, mais aussi ceux qui se souviennent qu’avant, on ne parlait pas autant du TSO parce que « ça ne se faisait pas vraiment, c’était perçu comme une faiblesse d’être malade ! »
Malgré tout, chaque ancien soldat reste avec des images qui lui colle à la peau. Des histoires d’horreur qui se sont produites au front et des histoires d’amour et d’amitié, comme on n’en retrouve que très rarement aujourd’hui. Et à Daphnée Seiz d’avoir le mot de la fin : « L’armée, oui ça peut être difficile, mais ce groupe-là, c’est ma famille. C’est ce regroupement-là qui m’a sauvée ! Et pourtant si demain, on devait tous le refaire, ce serait sans hésiter. Vous savez, ce n’est pas pour rien qu’on le dit… Soldat un jour, soldat toujours ! »